
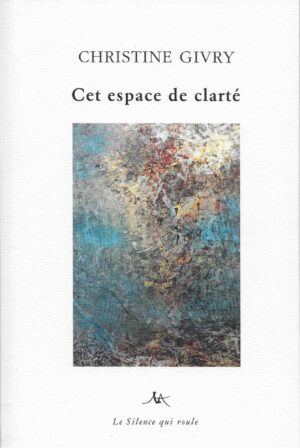
Christine Givry est née en 1951 et fut professeur de lettres Classiques. La poésie l’accompagne depuis de nombreuses années, dans la discrétion, pour rester « humble et passionnée exploratrice » des hommes, des lieux et des choses. Sa quête de la Beauté, ce « Jardin de roses » (W.B. Yeats), reste à l’écoute du fragile. Elle est résistance « contre la Ténèbre, qui ne serait peut-être qu’un autre état de la mort, en sa perfection, effroi et jubilation. » Les poèmes de Christine Givry sont publiés régulièrement dans les revues A.R.P.A et Thauma.
BIBLIOGRAPHIE :
La paix blanche, suivie de La mer des arbres, éd. Cahiers du Confluent, 1982
Le Tourment du monde, éd. Cahiers du Confluent, 1984
L’Appel des Présences, Imprimerie Artisanale de Montereau, 1986
Cet espace où s’émeut la Clarté, Imprimerie Artisanale de Montereau, 1988
Vers le dénudé du ciel, éd. de l’Arbre, 1994
Le Buisson brûlé, éd. de l’Arbre, 1999
Pierre nocturne, encres de Claude Galimard, éd. de La Renarde Rouge, 2002
Laisses de la mer trop tendre, lithographies de Jean-Paul Agosti, éd. Dutrou, 2007
Victorine sur le fil du temps, encres d’Isabelle Raviolo, éd. de La Renarde Rouge, 2013
Graines en dormance, éd. des Cahiers de l’Arbre, 2016
Cet espace de clarté, anthologie, choix de poèmes de l’autrice, éd. Le silence qui roule, 2019 – préface de Jean-Marie Barnaud (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Barnaud)
Traductions de l’allemand :
Le Chant de la terre de Gustav Malher, éd. Cahiers du Confluent, 1983
Les Gurre-Lieder d’Arnold Schoenberg, éd. Cahiers du Confluent, 1983
Conférences-expositions :
Emily Dickinson, la « femme en blanc », Bibliothèque municipale de Grasse, 1992 (conférence)
Les Échos de Mallarmé du Coup de dés… à l’informatique. Commissaire d’exposition, Orangerie des Musées de Sens, 1998
EXTRAIT DE LA PREFACE de JEAN-LOUIS BARNAUD
dans CET ESPACE DE CLARTE :
La poésie à l’épreuve des chemins
Chacun des livres de Christine Givry, inspiré par ses voyages, témoigne d’une expérience concrète des « chemins », où le corps est engagé dans une quête sans fin d’un lieu qui comblerait une attente essentielle, celle qu’expriment ces lignes de Le Buisson brûlé : « Sur cette terre à l’odeur de laine et de suint/que sommes-nous venus chercher que nous avons perdu/nous qui écrasons des fleurs sous nos pas »
Une inquiétude essentielle persiste donc au cœur de ces pérégrinations, ce qui n’est pas incompatible avec l’enthousiasme des départs : « repartir par un si beau chemin de blancheur », s’exposer à « l’ivresse des parfums », rencontrer la beauté du monde : autant d’expériences, et qui ravivent ou creusent l’inquiétude dont je parlais, laquelle précisément décèle en toute chose sa perte, et la présence de la mort au cœur même de la beauté.
Que de rencontres heureuses pourtant au cours de ces voyages : si nombreux en Grèce, terre d’élection, mais aussi en Afrique du nord : Atlas, Tassili, Djurjura, et en dernier lieu, l’Ouzbékistan.
Cela dit, d’autres destinations moins extrêmes sont aussi évoquées. L’ensemble fait de ces livres, de ces poèmes, autant de carnets de voyages qui révèlent aussi les contours d’une terre idéale dont rêve la narratrice : « Il y aurait à nouveau des jours/pour croire/pour faire confiance » ; « car il est sans doute un jardin à ouvrir ».
Nombreux sont les êtres du monde qui témoignent de ce jardin idéal et suscitent une contemplation émue : c’est le cas pour les arbres et pour les oiseaux. Les arbres sont le modèle d’une sagesse et d’une tendresse, d’une fidélité à la terre : il faut apprendre à se « faire une raison d’arbres ». Eux, au moins ne mentent pas : « leur tendresse est sans leurre. »
Quant aux oiseaux ils sont constamment présents. Non pas comme de simples éléments d’un décor, mais parce qu’ils sont eux-mêmes de nature poétique : si forts sont les liens que le regard du poète a tissés avec eux dans l’émerveillement que suscitent leurs vols et leurs chants. De là une sympathie, une connivence, qui inspirent, dans Cet espace où s’émeut la clarté, l’affirmation d’une véritable identification de la poète avec l’oiseau : « L’oiseau de la forêt /l’oiseau qui est passé dans le poème/y a laissé de son sang ».
Ce passage de l’oiseau, qui est par essence un être furtif, qualifie bien l’ensemble des rencontres avec ce non-pensé, ou plutôt la « pensivité » des animaux, selon le terme inventé par Jean-Christophe Bailly, pour qualifier la nature du regard qu’ils posent sur le monde et sur nous. Telle rapide rencontre avec un chamois et « son regard qui ne se sait pas », à la fois fascine et dérange car il nous renvoie à « notre tourment nu», qui est précisément la pensée de notre finitude. Tel est le don de ce « vertigineux espace animé du frisson des bêtes. »
Et l’on n’est pas loin ici de Rilke, dont Givry reprend la célèbre métaphore de la lettre à Witold von Hulewicz qui assimile le travail du poète à celui des abeilles, et lui fait dire : « Nous sommes les abeilles de l’invisible. Nous butinons éperdument le miel du visible. (…) » Et Givry, de son côté, dans L’appel des présences, affirme : « Nous sommes les abeilles qui vibrent dans le vol des oiseaux », la poète étant inspirée par ce rêve de toujours mieux approcher le mystère de « cet accord des choses avec les choses »…
la suite à retrouver dans le livre édité au Silence qui roule.
